Un peu d'histoire...
Par une Convention
du 29 octobre 1920, la Compagnie Générale de Télégraphie
Sans Fil avait obtenu du Secrétaire d'Etat de l'époque,
M Deschamps, une concession pour l'exploitation de liaisons internationales "avec
les Sociétés privées ou Administrations d'Etat
avec lesquelles la Société avait conclu ou viendrait à conclure
des accords de trafic".

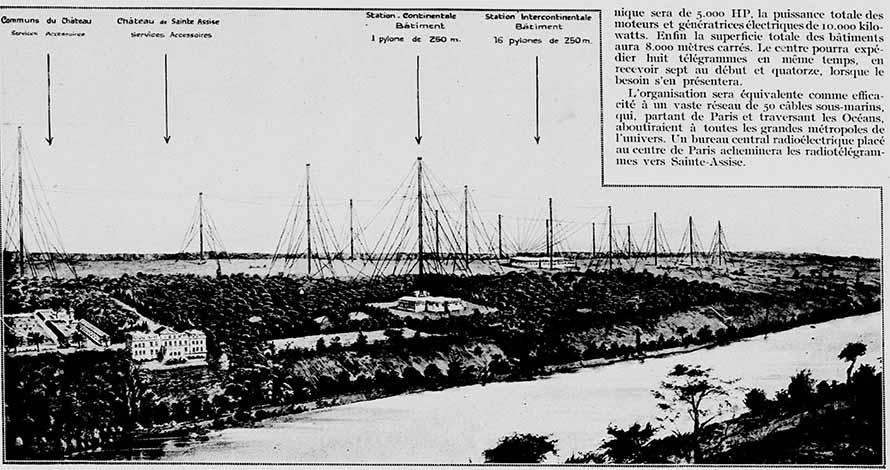
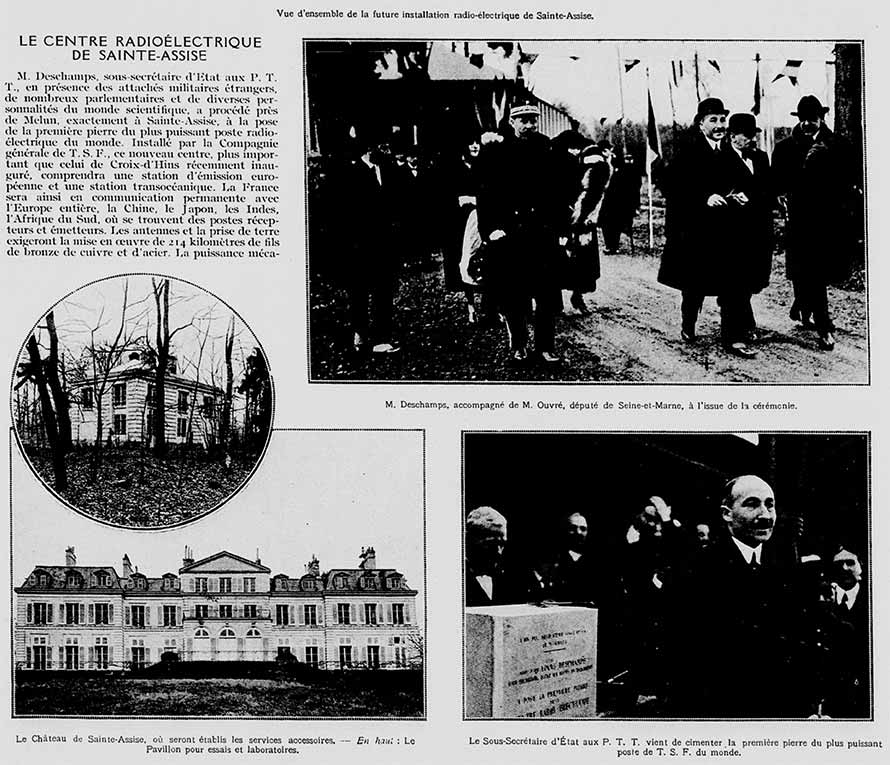
Le contrat auquel était assignée une durée de 30 ans,
partant du 1er janvier de l'année qui devait suivre l'achèvement
des travaux, prévoyait l'érection, par la Compagnie, dans un
délai de deux ans, après la signature de celui-ci, de deux stations
distinctes : l'une pour les liaisons avec les pays d'Europe, l'autre pour les
liaisons avec les pays hors d'Europe.Il était stipulé qu'en fin
de Convention, la totalité des immeubles de la Société aussi
bien que les installations réalisées pour l'exécution
du contrat reviendraient gratuitement à l'Etat.
Après l'adoption du site de Sainte-Assise, d'une superficie de 450 hectares,
la Compagnie Générale de Télégraphie Sans Fil décida
d'y réunir les deux stations dénommées par la suite Transcontinentale
et Continentale, mais qui, dans le projet initial, avaient été conçues
comme entièrement distinctes; les installations d'énergie de
secours, par exemple, étaient indépendantes les unes des autres.
Elle créa, en outre, pour lui être substituée dans l'exécution
du contrat, une filiale spécialisée sous le nom de Radio-France.
Remarquablement organisés et de surcroît favorisés en 1921
par un été exceptionnel, les travaux permirent d'aboutir à la
mise en service de la Station Continentale en octobre 1921 et à celle
de la Station Intercontinentale le 7 août 1922. Entre temps, la Compagnie
avait obtenu l'autorisation d'ouvrir un service radiotélégraphique
avec Londres et un émetteur à lampes de quelques centaines de
watts, installé provisoirement dans les communs de Sainte-Assise, pouvait
fonctionner en permanence à partir du printemps de 1921. Vers 1925,
Radio-France disposait ainsi de cinq postes de transmission commandés
chacun directement par la table de trafic de la liaison correspondante du Bureau
Central de la Compagnie à Paris :
- Le poste de transmission Paris-Londres : 3 chevaux, 2.000 à 3.000
mètres de longueur d'onde.
- Un poste double à la Station Continentale permettant deux liaisons
simultanées pour l'Europe et l'Asie Mineure: 25 kW par élément
et 9.000 à 10.000 mètres de longueur d'onde.
- Un poste double à la Station Transcontinentale permettant deux liaisons
simultanées pour l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud,
la Chine et le Japon : 2 éléments de 250 kW et 2 éléments
de 500 kW, 15.000 mètres et 20.000 mètres de longueur d'onde,
l'un servant de secours à l'autre. A l'apparition des ondes courtes
et en marge du contrat, la Compagnie fit l'acquisition de 6 émetteurs à ondes
courtes; quatre émetteurs étaient du type double à autoexcitation
de la Société Française de Radioélectricité,
un cinquième provenant de la compagnie anglaise Marconi Wireless était
du même modèle que ceux avec lesquels cette compagnie avait équipé le
réseau impérial britannique. Le sixème émetteur
fabriqué par la Société Française de Radioélectricité et
stabilisé par un oscillateur à quartz vint s'y ajouter vers 1929.
Les puissances rayonnées étaient de l'ordre d'une dizaine de
kilowatts. Les longueurs d'onde allaient de quinze à soixante mètres.
Par la suite, d'autres émetteurs appartenant à la Compagnie Générale
de T.S.F. et dont Radio-France assurait l'exploitation en régie, avaient été installés
dans les locaux des Stations Continentale et Transcontinentale; ils étaient
affectés à des liaisons radiotéléphoniques vers
l'Amérique du Sud et l'ExtrêmeOrient.
Aux alentours de 1936, les émetteurs à autoexcitation furent
remplacés par des émetteurs pilotés par quartz de conception
simple et de réalisation robuste construits par RadioFrance à l'atelier
de Sainte-Assise. En 1939, à la déclaration de guerre, le Centre
d'émission de Sainte-Assise assurait les communications radiotélégraphiques
avec l'Amérique du Sud, la Chine, le Japon, le ProcheOrient et les principales
capitales d'Europe. En radiotéléphonie, mais sous le couvert
d'accords extracontractuels entre la Compagnie Générale de Télégraphie
Sans Fil et l'Administration, les liaisons étaient assurées avec
Buenos-Aires, Rio de Janeiro, Saigon, Le Caire et les paquebots du Sud-Atlantique
pendant toutes leurs traversées.
Au moment de la Libération, les Allemands détruisirent complètement
la grande Station Transcontinentale, bâtiment compris. Ils n'avaient
toutefois fait qu'endommager superficiellement le matériel des autres
stations, mettant cependant le Centre dans l'incapacité provisoire d'assurer
une seule liaison. Cet état de choses ne dura pas longtemps car, en
moins de quinze jours, deux liaisons à ondes courtes pour New York et
Londres étaient utilisées par le G.Q.G. allié et la liaison
commerciale reprenait avec l'Angleterre grâce à la remise en état
de deux postes à lampes de 3 kilowatts à ondes moyennes. Petit à petit,
les émetteurs à ondes courtes étaient reconstitués
et permettaient une augmentation progressive du nombre des voies exploitées.
L'exploitation sur ondes moyennes avait de même été rétablie
avec deux émetteurs à lampes et deux alternateurs haute fréquence
de 25 kW sur 9.000 à 10.000 mètres de longueur d'onde; un émetteur
appartenant à l'Administration et qui avait été installé successivement à la
station de Pontoise puis à celle de Croix d'Hins était venu s'y
ajouter.
De 1945 à 1954, le nombre des émetteurs à ondes courtes
de télégraphie fut porté à 18, auquel s'ajoutaient
deux émetteurs de modèle ancien, susceptibles de travailler en
téléphonie ainsi qu'un émetteur à bande latérale
unique (BLU) du type 1944-47 à cinq longueurs d'ondes préréglées.
Au titre des travaux de reconstruction, financés par le Ministère
de la Reconstruction et de l'Urbanisme, la Compagnie équipa, de 1950 à 1953,
la Station à ondes longues de deux alternateurs 250 kW Bethenod-Latour,
pouvant fonctionner jusqu'à 20 kHz (15.000 mètres de longueur
d'onde), ainsi qu'un émetteur à ondes moyennes de 45 kW. En même
temps, étaient également installés un émetteur
de 150 kW et un deuxième de 45 kW appartenant l'un et l'autre à l'Administration.
Deux des 17 pylônes de 250 mètres existant avant la guerre avaient été endommagés,
douze d'entre eux ont été maintenus à leur hauteur initiale
tandis que trois autres étaient déplacés et raccourcis à 180
mètres pour supporter les antennes des nouveaux émetteurs à ondes
moyennes.
L'antenne principale est actuellement constituée par quatre pyramides
renversées, à base carrée de 400 mètres de côté.
Elle couvre, à elle seule, une superficie de 64 hectares. Dès
avant et depuis la cessation des activités de la Compagnie Radio-France,
les dispositions prévues par la Direction des Services Radioélectriques
ont été orientées vers l'adoption de solutions radicales;
celles-ci visaient à accélérer en matière d'exploitation,
l'intégration de Sainte-Assise dans le programme général
d'entraide, de développement et de modernisation des Stations du Service.
Deux ans avant la date prévue pour l'expiration du contrat, l'exploitation
des liaisons radiophototélégraphiques pour le compte de la Compagnie
Générale de T.S.F. avait été interrompue; celle
des liaisons radiotéléphoniques le fut un an plus tard, soit
au 1er janvier 1953, tandis que la construction du bâtiment
d'émission Nord-Ouest, pour le compte de l'Administration, était
amorcée.
Dans le courant de 1954, une partie des liaisons télégraphiques
de la Compagnie Radio-France fut transférée sur les émetteurs
plus modernes des autres Stations de l'Administration; il fut ainsi possible
d'interrompre complètement l'exploitation de l'ancienne Station Continentale
au moment même où la livraison des premiers émetteurs BLI
type 1954 permettait d'ouvrir au service permanent le bâtiment Nord-Est
de Sainte-Assise; l'exploitation radiotéléphonique, entièrement
concentrée à Pontoise pendant près de deux ans, fut répartie
entre les deux Centres.On devait opérer de même en 1956, en réduisant
l'exploitation du groupe des bâtiments Sud-Est à l'entrée
en service du bâtiment Nord-Ouest; ce bâtiment était achevé et
ouvert à l'exploitation au mois de mars 1956. Le programme de construction
d'habitations, d'ateliers et de magasins adéquats était exécuté et
le troisième bâtiment d'émission Sud-Ouest fut ouvert au
service à partir de 1959. Entre temps, les installations d'alimentation
d'énergie avaient été sensiblement améliorées
et renforcées.Une ligne haute tension entièrement souterraine
avait été mise en service entre Sainte-Assise et le poste de
sectionnement de l'Electricité de France dit du "Pont de Mée",
près de Melun. La puissance de la centrale thermique a été portée à 2.200
kW. L'ancien câble aéroporté a été abandonné.
Le nombre des circuits de liaisons avec Paris a été augmenté et
ils ont été répartis entre deux puis trois câbles
souterrains entièrement distincts.En juillet 1970, le nombre des émetteurs
installés est de 70 répartis comme suit :
Bâtiment Ondes Longues ou Nord-Est :
- 2 émetteurs, ondes myriamétriques de 125 kilowatts.
- 4 émetteurs, ondes kilométriques de 60 à 150 kilowatts.
- 6 émetteurs B.L.I., ondes décamétriques de 35 kilowatts.
Bâtiment Nord-Ouest :
- 6 émetteurs B.L.I. ondes décamétriques de 60 kilowatts.
- 15 émetteurs B.L.I. ondes décamétriques de 35 kilowatts.Bâtiment
Sud-Ouest :
- 23 émetteurs B.L.I. ondes décamétriques de 20 kilowatts.Groupe
Sud-Est (trois petits bâtiments) :
- 14 émetteurs ondes décamétriques - télégraphie
mono-onde de 10 kilowatts. Tout en poursuivant l'extension des installations,
on s'attachait à maintenir la plus grande homogénéïté possible
dans l'équipement général des bâtiments et, sauf
impossibilité, à la respecter rigoureusement à l'intérieur
de chaque salle. Pour les émetteurs du Groupe Sud-Est enfin, on a poussé au
maximum la recherche de la sécurité de fonctionnement afin d'en
rendre possible l'exploitation télécommandée depuis le
Bâtiment Sud-Ouest.Enfin, et parallèlement, on entreprenait non
seulement le développement des moyens de contrôle afin d'en rendre
l'utilisation instantanée et de les mettre à la portée
des exploitants, mais encore celui des dispositifs de surveillance avec signalisation
automatique des défauts, tout ceci dans le cadre d'un programme d'entraide
méthodique et d'amélioration commun aux différents Centres
du Service. Parmi les principales innovations apportées sur le plan
technique, on citera encore :
- Le développement systématique des grilles bifilaires 600 ohms
de répartition des aériens et des losanges doubles concentriques
suivant la technique amorcée au Centre de Pontoise.
- L'utilisation d'émetteurs à sortie coaxiale avec passage de
60 ohms dissymétriques à 600 ohms symétriques par des
lignes exponentielles avec ligne d'équilibrage et capacités série.
Cette technique doit permettre une commutation émetteurs-aériens
plus rapide et totalement indépendante du reste du trafic.
Le trafic du Centre de Sainte-Assise, étroitement associé à celui
des trois autres centres d'émission, comprend :
Trafic point à point :
émissions radiotéléphoniques; émissions radiotélégraphiques
de type F1 F6 (duoplex); multiplex harmoniques, TOR et MUX en direction de l'Afrique
du Nord et Centrale, des deux Amériques et de l'Asie.
Trafic de diffusion :
Ce trafic est utilisé par : les Agences de presse; la Météorologie
Nationale. bulletin et cartes météorologiques (fac-similé);
le Centre National d'Etudes Spatiales et le Centre National d'Etudes des Télécommunications
pour des émissions spéciales à caractère scientifique.
Il concerne plus particulièrement les ondes longues dont les caractéristiques
de propagation se prêtent particulièrement bien à ce genre
d'utilisation.
Quelques chiffres
:
- une superficie de 450 hectares.
- 70 émetteurs de 10 à 250 kilowatts.
- des liaisons avec 45 pays répartis dans le monde entier.
- 132 antennes supportées par 377 pylônes de 25 à 250 mètres,
reliées aux bâtiments par 110 kms de feeders bifilaires.
- 11.000 mètres de bâtiments techniques.
- 14 kms de réseau routier dont 7 kms goudronnées.
Plus près
de nous...
Le 4 août
1984, le lancement du premier satellite géostationnaire de télécommunication
français Télécom 1A fait entrer le centre de Saint
Assise dans l'histoire de la transmission par satellite, tandis que
les transmissions dites à ondes longues disparaissent peu à peu.
Le centre prend en charge l'exploitation et la maintenance de stations
terriennes du réseau de transmission de données Télécom
1.
Le 31 décembre 1990, les deux derniers circuits radio-téléphoniques
avec les îles Commores sont arrêtés et l'exploitation de
la partie transmission ondes longues restante est donnée à la
Marine Nationale. L'antenne, supportée par les 10 pylônes de 250
mètres est désormais à l'usage exclusif de la Force Océanique
Stratégique.
Le 1er novembre 1992, le Centre de Télécommunications par Satellite
de Saint Assise est créé, remplaçant le Centre de Transmission
Radio Electrique. La mise en service d'une première station équipée
d'une antenne parabolique de 13 mètres de diamètre permet la
mise sur orbite du "bouquet" de programmes de télévision
sur le satellite Télécom 2A. 11 programmes de télévision,
dont 2 dans le format 16/9, sont à destination des réseaux câblés
et des antennes de réception directe installées chez les particuliers.
L'installation de nouvelles stations va élargir le domaine d'activité du
centre.
Aujourd'hui, outre les satellites français de la génération
Télécom, des programmes TV sont émis vers les satellites
des organisations internationales Eutelsat, Intelsat et la Société Européenne
de Satellite (SES). C'est près de 40 programmes de télévision
et 15 programmes de radio qui sont émis depuis Saint Assise. Depuis
quelques mois, le centre de Saint Assise s'est spécialisé dans
les procédés de transmission de TV numérique, ce qui le
place dans une position privilégiée dans le développement
de ces technologies d'avant-garde. C'est le premier centre à émettre
sur satellite des programmes de télévision en numérique à destination
du grand public.
Le Centre de Télécommunications par Satellite se spécialise
aussi dans la construction et la mise en service de réseaux d'entreprise
par satellite tant dans le domaine de l'audiovisuel que dans les transmissions
de données. Un laboratoire de développement et de mise au point
permet de tester les nouvelles technologies qui arrivent sur le marché international
et de réparer les équipements venant du territoire national.
Des stations transportables de reportage, aérotransportables ou embarquées
sur camions, sont exploitées par une équipe du Centre de Saint
Assise. Intervenant dans le monde entier, elles ont permis de suivre en direct
les grands événements de notre époque, aussi divers que
: le tremblement de terre en Arménie, la guerre du Golfe, la guerre
du Rwanda, les accords de paix du Proche Orient, ou les événements
sportifs tels le tour de France, le rallye Paris-Dakar, les grands prix de
Formule 1, le tournoi de Roland Garros, la coupe du monde de football, etc...
Ainsi le CTS de
Saint Assise est encore en mutation, et se place toujours à la
pointe des technologies modernes de communications. Signe de cette
mutation et sa place à la pointe des technologies de communications,
il y a quelques mois à peine, le Centre de Télécommunications
par Satellite est devenu "TéléPort de St Assise".
À suivre...
|